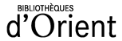Joseph Arthur de Gobineau fut nommé en 1855, pour une durée de trois ans, secrétaire d’une mission diplomatique en Perse. Il ne pouvait rêver meilleure destination. Pendant son adolescence, en Bretagne, il s’était enivré des Mille et une Nuits.
Son Essai sur l’inégalité des races humaines (1853-1855) venait d’accréditer la légende qui situe aux abords du Caucase le berceau de la race aryenne. Pendant son adolescence, en Bretagne, il s’était enivré des Mille et une Nuits. « Il ne rêvait que mosquées et minarets, se disait musulman, prêt à faire son pèlerinage à la Mecque », racontera une de ses amies d’enfance. À peine arrivé à Paris, en 1835, il a suivi au Collège de France les cours de persan de Quatremère avant de céder dans un long poème, Dilfiza (1837), à la mode orientaliste de l’époque ; il a aussi tenté, sans succès, de fonder une Revue de l’Orient.
Dès qu’il y aborde, l’Orient l’enchante. Plus éclatant qu’en Europe, son ciel étoilé sera, jusque dans son roman Les Pléiades (1874), la métaphore d’une sphère supérieure dont la fixité échappe à la décadence du monde d’ici-bas. Stable et respectueuse de la hiérarchie, la société persane est à l’opposé de celle qui a, lors des journées révolutionnaires de 1848, exacerbé son horreur de la démocratie. Les derviches représentent, à ses yeux, les authentiques mystiques du monde moderne. Parce qu’elles ne séparent pas le vrai du faux et s’ouvrent à l’imagination, les philosophies orientales conviennent à son tempérament ; elles lui offrent un renfort contre les vétilleux savants occidentaux qui accusent de légèreté ses vues historiques et ses théories raciales. Il est vrai que l’expérience le conduit vite à déchanter : « De race persane, il n’en existe pas plus, dans le sens scientifique du mot, qu’il n’y a de race française », écrit-il à Tocqueville le 15 janvier 1856. Mais il accordera toujours plus d’indulgence aux défauts des Orientaux qu’à ceux des Européens. Son séjour lui inspire Trois ans en Asie (1859), récit de voyage qui vaut moins par les descriptions de paysages, plutôt conventionnelles, que par les portraits d’Orientaux rencontrés en chemin, de savoureuses anecdotes, ainsi que par la verve du polémiste qui entend « dire aux Européens ce qu’il pense de leur civilisation ». Mû par une tenace ambition de linguiste, il publie Lectures des textes cunéiformes (1858) et prépare un Traité des écritures cunéiformes (1864). De ce mode d’écriture de la Perse ancienne, on a, selon lui, ignoré jusqu’à présent la valeur symbolique. Les spécialistes jugeront ses trouvailles dépourvues de tout intérêt scientifique. Sa réplique sera sans appel : « Les savants sont bêtes ».
Il revient à Téhéran, en janvier 1862, avec le titre de ministre plénipotentiaire. Durant ce second séjour, il poursuit l’écriture d’une volumineuse Histoire des Perses (1869), où Cyrus ressemblera trop à un chevalier du Moyen Âge pour convaincre des historiens patentés, et compose Religions et philosophies dans l’Asie centrale (1865). Loin de placer le souverain bien dans « les avantages de la vie matérielle, de la vie sociale ou politique », les Orientaux « ont besoin d’un monde qu’on ne voit pas ». L’ouvrage contient des considérations, utiles encore aujourd’hui, sur le chiisme, le soufisme ou le babisme, ainsi que sur la survivance du théâtre traditionnel en Perse. Gobineau entreprend aussi de faire traduire en persan le Discours de la méthode afin de montrer combien les philosophies orientales se distinguent de ce positivisme cartésien qu’il déteste. « Les Asiatiques se trompent sans doute ; ils ont pourtant une chose de leur côté : c’est la grandeur et la puissance et la hardiesse de leurs hypothèses », écrit-il au comte de Prokesch-Osten le 20 juillet 1862.
« Je sais bien que revenu en Europe, je pleurerai l’Asie tout le reste de ma vie », lui avait-il confié le 20 mars 1857. En souvenir des Mille et une Nuits, il surnomme les trois héros des Pléiades « calenders, fils de Roi ». Les Nouvelles asiatiques (1876), surtout, illustrent sa nostalgie. Trois de ses six récits (« L’Illustre Magicien », « Histoire de Gambèr-Aly », « La Guerre des Turcomans ») peignent avec humour et tendresse les défauts des Persans d’aujourd’hui (dissimulateurs, versatiles, dupes de tout ce qui brille) ; deux autres (« La Danseuse de Shamakha » et « Les Amants de Kandahar ») exaltent des individus qui ont préservé, à l’abri des montagnes du Caucase ou de l’Afghanistan, la force de caractère et la noblesse de leur race originelle. On se demande, quand il use d’un style emphatique et fleuri, s’il se moque ou se fait complice des Orientaux, mais cette ambiguïté contribue au charme de ses nouvelles. La dernière du recueil, « La Vie de voyage », est une transposition romanesque de sa première mission, où l’avait accompagné son épouse. « L’Asie est un mets très séduisant, mais qui empoisonne ceux qui le mangent », avait-il écrit dans Trois ans en Asie. Malade tout au long du voyage, Lucie, l’héroïne de la nouvelle, en rapportera pourtant « les sensations les plus heureuses, les plus brillantes, les plus inoubliables » qu’elle ait éprouvées.