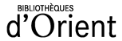Des tentatives de réforme de la fin du XVIIIe siècle à la révolution jeune-turque de 1908 et de l’expédition d’Égypte à la Grande Guerre, l’Empire ottoman est aux prises avec une modernité qui menace son intégrité territoriale et l’équilibre fragile d’une population pluriethnique et pluriconfessionnelle.
test
Accès rapides :
Les revers militaires essuyés pendant le dernier quart du XVIIIe siècle forcent l’Empire ottoman à se remettre sérieusement en question. En effet, avec le traité de Küçük Kaynarca de 1774, la Russie s’était imposée comme une puissance de plus en plus menaçante par ses velléités expansionnistes, doublées d’une influence croissante sur les populations chrétiennes orthodoxes de l’empire. En 1798, le coup de force de Bonaparte en Égypte met à nu la faiblesse de l’État ottoman : il lui faudra trois années et, surtout, le soutien de l’Angleterre pour mettre fin à l’occupation d’une de ses plus riches provinces.
Des efforts de réforme s’étaient succédé depuis le XVIIe siècle, notamment en matière d’organisation financière et militaire. Au tournant du XIXe siècle, toutefois, ces efforts sont désormais marqués par une volonté expresse de s’inspirer d’exemples occidentaux, surtout français, et de s’attirer les sympathies et le soutien des puissances européennes. Selim III (r. 1789-1807) entreprend ainsi d’établir un « ordre nouveau » (Nizam-ı Cedid), tandis que des ambassades permanentes sont envoyées pour la première fois dans les principales capitales d’Europe. Pendant les guerres napoléoniennes, le gouvernement ottoman navigue d’une alliance à l’autre pour survivre dans un monde où il ne peut désormais plus s’isoler.
Les réformes reprennent de plus belle sous Mahmud II (r. 1808-1839) qui, après avoir préparé le terrain, consacre la seconde moitié de son règne à rétablir le contrôle sur la périphérie de l’empire. Il doit cependant faire face à deux crises majeures. La révolte grecque de 1821 prend vite de l’ampleur et, poussée par le philhellénisme, se transforme en guerre d’indépendance. La bataille de Navarin (1827) retourne la situation en faveur des Grecs et le conflit avec la Russie de 1828-1829 achève la résistance ottomane. La Grèce naît dans la foulée de ces interventions européennes.
La crise égyptienne est encore plus grave : Mehmed Ali, gouverneur d’Égypte, vassal volant au secours de l’empire pendant la révolte grecque, se retourne contre son suzerain. L’avancée des troupes égyptiennes en Anatolie menace la capitale et le sultan ne se tire d’affaire qu’en se mettant sous protection russe en 1833. Quelques années plus tard les hostilités reprennent avec un résultat semblable ; cette fois-ci c’est l’Angleterre qui vole au secours de la Porte et force le pacha d’Égypte à se contenter d’une autonomie vis-à-vis d’Istanbul. Le pire est évité, mais l’empire perd son emprise sur une riche province qu’il détenait depuis plus de trois siècles.
Malgré ces déconvenues, Mahmud II mène ses réformes d’une main de fer. Au milieu de la crise grecque, en 1826, il détruit et abolit le corps des janissaires pour établir une armée à l’occidentale. Suivent nombre d’institutions « modernes », ministères, conseils, écoles, dont l’objectif est double : moderniser et centraliser l’État qui tourne rapidement à l’autocratie. L’engouement de Mahmud pour la modernité va jusqu’à imposer une tenue occidentale aux fonctionnaires, à l’image de l’uniforme dont il avait déjà affublé l’armée. Sa mort en 1839 est un soulagement, notamment pour les dignitaires dont la carrière et, souvent, la vie, était à la merci de ses caprices. L’occasion se présente ainsi de limiter l’autorité du souverain tout en introduisant des réformes susceptibles d’attirer le soutien de l’Europe à un moment où la crise égyptienne bat son plein.
L’édit des Tanzimat (réorganisation) est ainsi promulgué quelques mois après l’avènement du très jeune Abdülmecid (r. 1830-1861) qui accepte de voir ses pouvoirs réduits par des mesures qui garantissent la vie, la fortune et l’honneur des sujets – et surtout des dirigeants – de l’empire. On y promet aussi une meilleure répartition de l’assiette fiscale, une conscription moins opprimante et l’application de ces mesures à tous les sujets du sultan, musulmans ou non. Ce dernier point répond en partie à l’attente des puissances européennes de voir les chrétiens émancipés du statut inférieur de zimmi/dhimmi que leur impose la Charia et constitue ainsi un premier pas vers une notion d’égalité, voire de citoyenneté. L’édit établit les bases encore timides d’un État de droit confié à une classe de bureaucrates et d’hommes d’État.
La période des Tanzimat – prenant son nom de cet édit « fondateur » – s’inscrit donc dans un contexte de modernisation par l’occidentalisation dans pratiquement tous les domaines : administration, instruction, presse, communications, urbanisme, architecture, arts, littérature… L’alliance avec la France et la Grande Bretagne pendant la guerre de Crimée en constitue un couronnement plein d’ambigüités. L’égalité des sujets est reconnue, mais surtout parce qu’elle a été exigée par les alliés ; l’empire est admis au sein de l’Europe, mais au prix d’un droit d’ingérence accordé aux grandes puissances ; le développement économique est encouragé, mais dans des conditions qui laissent déjà présager des rapports de force quasi coloniaux avec l’Occident. L’exemple le plus flagrant est celui de l’endettement. Le gouvernement, appâté par des emprunts très favorables pendant la guerre, poursuit cette politique pour pallier le déficit chronique du trésor. Une mauvaise gestion des revenus, l’absence d’investissements productifs et les sommes englouties dans des projets faramineux enclenchent le cercle vicieux d’emprunts contractés pour payer les précédents.
Abdülaziz (r. 1861-1876) joue la carte de l’économie, de la tradition et de la piété pour prendre ses distances par rapport aux « péchés » de son frère. Cependant, ses prétentions islamiques ne vont guère au-delà de gestes symboliques et ses dépenses dépassent bientôt celles de son prédécesseur. Malgré des velléités d’autocratie, les hommes d’État se chargent de sauvegarder les principes des Tanzimat. L’ottomanisme – une politique qui tente de rassembler tous les sujets autour d’une identité impériale commune – est maintenu, de même que l’attachement aux grandes puissances. En 1867, le sultan visitera les capitales européennes – dont Paris lors de l’Exposition universelle. Il recevra également des têtes couronnées – dont Eugénie en 1869 – dans sa capitale. La banqueroute de l’État, les fastes de la couronne, une opposition opprimée et l’explosion de violences dans les Balkans ont raison d’Abdülaziz qui est déposé par un coup d’État en 1876. Il est remplacé par Murad V, espoir des libéraux et des constitutionnalistes, mais qui, suite à une dépression majeure, doit céder le trône au bout de trois mois à son frère Abdülhamid II (r. 1876-1909).
L’avènement d’Abdülhamid II constitue un tournant décisif. S’il arrive au pouvoir les mains liées par une situation de fait qu’il ne contrôle pas, il ne tarde pas à se libérer de ses entraves. Il approuve la promulgation de la première constitution, mais s’empresse d’écarter son promoteur, Midhat Pacha. Au bout d’une année, profitant de la défaite cuisante de l’empire face à la Russie, il dissout le parlement et suspend la constitution. L’empire entre ainsi dans la voie de l’autocratie que le sultan bâtit patiemment en démantelant les institutions des Tanzimat et en les remplaçants par des réseaux informels qui aboutissent au palais, centre névralgique de son pouvoir personnel. En matière de diplomatie, il sait profiter des dissensions entre les grandes puissances et montre parfois la carte du califat, qui lui donne une emprise symbolique sur l’islam sunnite, pour menacer les empires britannique et français aux fortes populations coloniales musulmanes. Toutefois, en règle générale, il se garde bien d’antagoniser les grandes puissances auxquelles il cède de nombreux territoires – Chypre (1878), Tunisie (1881), Égypte (1883) – tandis que d’autres acquièrent leur indépendance – Roumanie (1878) – ou une forme d’autonomie ou de tutelle étrangère – Bulgarie et Bosnie-Herzégovine (1878), Crète (1898). Surtout, il règle le problème de la dette en autorisant la création de l’administration de la Dette publique ottomane, sorte de consortium multinational qui saisit un tiers des revenus de l’État pour garantir les revenus des porteurs occidentaux, ouvrant ainsi la voie à l’impérialisme.
À l’intérieur, il divise pour mieux régner. Le flot de réfugiés musulmans des Balkans après la défaite de 1878 modifie le profil démographique de l’Anatolie que l’exode du Caucase avait déjà commencé à islamiser. Conscient des pertes irréversibles en Europe, Abdülhamid mise désormais sur l’islam comme dernier espoir de maintenir l’empire debout. Il tente de s’assurer la loyauté des populations arabes et musulmanes par un discours (pan)islamiste et des investissements de la Syrie au Hedjaz. En Anatolie, il s’agit de monter la population musulmane contre les non musulmans, notamment les Arméniens, dont les velléités d’autonomie ou d’indépendance à l’issue du congrès de Berlin (1878) sont perçues comme un danger. Il s’ensuit des massacres et des pogroms en Anatolie, mais aussi jusque dans la capitale (1894-1896).
Les massacres ne sont pas une nouveauté dans cet empire pluriethnique et pluriconfessionnel, mais ils ont désormais changé de nature. Les massacres « traditionnels » sont dus à des représailles ponctuelles (Chio 1822) ou à des conflits intercommunautaires (Syrie 1860) ou à une combinaison des deux (Bulgarie 1876). Avec Abdülhamid, ils prennent une ampleur sans précédent, grâce à la participation ou du moins l’aval de l’armée et des forces de l’ordre. Il s’agit désormais d’une politique du sultan qui combine intimidation et nettoyage ethnico-confessionnel pour assurer la survie d’un empire qui se définit désormais selon des critères religieux.
Si le régime d’Abdülhamid parvient à se maintenir par l’oppression, la violence, la censure et le soutien tacite de l’Europe, il finit par céder devant la montée de l’opposition jeune turque, nourrie par des révolutionnaires « turcs » et arméniens et, surtout, par de jeunes officiers. C’est ce dernier élément qui assure le succès de la révolution de 1908 qui rétablit la constitution et le parlement, débouchant sur un éphémère « printemps des peuples ottomans ». En effet, la guerre de Tripolitaine et les guerres balkaniques mènent à une militarisation du système, accentuée par la débâcle de 1913. Fort d’un nationalisme turco-islamique exacerbé, les leaders du comité Union et progrès s’instituent en dictature. L’entrée en guerre aux côtés de l’Allemagne en 1914, dernier pari désespéré d’un État aux abois, cause la ruine de l’empire et, dans un paroxysme de violence, l’annihilation de la population arménienne. Sur les décombres de l’empire s’élèvera, après des années de conflit, la République de Turquie qui s’inscrira, non sans ambigüité, à la fois dans la continuité et la répudiation de l’héritage ottoman.
Publié en juillet 2021.