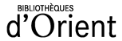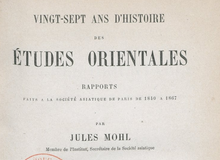Fruits tardifs de l’humanisme et de la philologie biblique, les traces d’un enseignement de la langue arabe en France demeurent ténus.
Ce fut en 1538 que François Ier, dans le cadre de la création d’un Collège des lecteurs royaux (le futur Collège de France) sur la Montagne-Sainte-Geneviève, accorda à Guillaume Postel le titre de « lecteur » en grec, arabe et hébreu. Entre 1538 et 1543, l’orientaliste publia, pour la seule langue arabe, son alphabet au sein d’un ouvrage consacré aux alphabets des douze langues, une Grammatica arabica (la première en Occident) et une nouvelle traduction de la première sourate, la Fatiha, destinée à l’édition du Coran par Theodor Bibliander, à Bâle en 1543. Par la suite, les détenteurs de la chaire d’arabe au Collège royal cumulèrent la charge de secrétaires-interprètes du roi pour les langues « arabe, turque, persane et tartare » qui, comme leur nom l’indique, réalisaient les traductions des documents pour la couronne. Parmi les plus célèbres interprètes royaux figurent François Pétis de la Croix, D’Herbelot, Antoine Galland, Cardonne.
De leur côté, les ambassades installées à Istanbul et les consulats étrangers établis dans les Échelles du Levant et autre lieux d’échange à partir du XVIe siècle, n’ont jamais pu se dispenser de recruter des interprètes, que l’on désigne par les mots terdjümân, truchements, torcimania, dragomans ou drogmans. Leur recrutement s’est d’abord agi de sujets non-musulmans du sultan : catholiques, arméniens, orthodoxes, maronites, juifs. Mais les diplomates étrangers leur faisaient constamment le grief de dépendre trop étroitement de leurs maîtres ottomans et aussi de se laisser acheter par le plus offrant. C’est ce qui conduisit plusieurs des pays représentés à Istanbul à se doter d’écoles de « jeunes de langues » pour disposer de drogmans qui soient des nationaux.
Depuis 1551, Venise envoie étudier à Istanbul de jeunes citoyens, les Giovanni della lingua. Lorsque la France décide à son tour d’ouvrir une école, elle ne fait que copier le modèle vénitien, d’ou la traduction « d’enfants de langues », puis celui de « jeunes de langues » qui s’impose. C’est à Colbert que l’on doit, à la demande de la Chambre de Commerce de Marseille, par arrêté du 18 novembre 1669, la création d’une école d’interprètes de carrière « devant servir de drogmans aux ambassadeurs et consuls de France en Orient ». Il est prévu à l’origine que six « Jeunes de langues », âgés de neuf à dix ans, seraient envoyés au couvent des capucins d’Istanbul et d’Izmir. Seule l’école d’Istanbul fonctionna plus ou moins bien. Faute de résultats satisfaisants, en 1700, il fut décidé que les apprentis-interprètes commenceraient leurs études au collège Louis-le-Grand à Paris et seraient envoyés vers l’âge de vingt ans à Istanbul. En 1721, nouvelle réforme : l’école est réservée à dix jeunes Français originaires soit du Levant, soit de métropole. C’est de cette époque que date l’obligation, pour les personnes revêtues de la charge de secrétaire-interprète du roi, de donner des leçons à l’école des Jeunes de langues.
Rattachée au ministère des Affaires étrangères en 1796, cette école fonctionna jusqu’en 1873 date à laquelle elle fusionna avec l’École spéciale des langues orientales vivantes. Cette dernière, établie à la Bibliothèque nationale, est née sous la Convention nationale, le 10 germinal an III (30 mars 1795). En 1873, à l’initiative de son président Charles Schefer, elle sera transférée dans un hôtel particulier situé au coin de la rue des Saints-Pères et de la rue de Lille. En 1971, elle prendra le nom d’Institut national des langues et civilisations orientales (INALCO), plus connue sous le surnom familier de Langues O'.
Au début du XIXe siècle, Paris est devenu le centre des études orientales en Europe. Il était en effet possible d’apprendre l’arabe, le turc et le persan dans trois établissements : un enseignement scientifique et littéraire au Collège de France où s’illustrèrent à la chaire d'arabe Jean-Jacques-Antoine Caussin de Perceval et de turc Abel Pavet de Courteille. L’apprentissage des langues orientales dans un but d’application et d’utilité politique et commerciale à l’École spéciale des Langues orientales vivantes sous la conduite d’Antoine-Isaac Silvestre de Sacy pour l’arabe littéral et Armand-Pierre Caussin de Perceval pour l’arabe vulgaire ; Louis Langlès et Etienne Quatremère pour le persan ; Amédée Jaubert, Charles Barbier de Meynard et Charles Schefer pour le turc. En outre, le gouvernement continua d’entretenir au Collège Louis-le-Grand les Jeunes de Langues destinés à devenir drogmans dans les échelles du Levant.
Tandis que se met en place un orientalisme savant au XIXe siècle, le monde intellectuel ressentit la nécessité de disposer d’une publication régulière émanant d’une association reconnue. Ainsi prit naissance dès 1822, la Société Asiatique. Celle-ci publia aussitôt un périodique, le Journal Asiatique, qui n’a plus cessé de paraître jusqu’à nos jours.
Le XIXe siècle et la première moitié du XXe siècle marquent l’apogée de l’orientalisme académique, époque où la France était grande puissance, en expansion vers l’Afrique et l’Asie, plaçant sous son contrôle plus ou moins direct, plus ou moins puissant, colonies, protectorats et mandats.